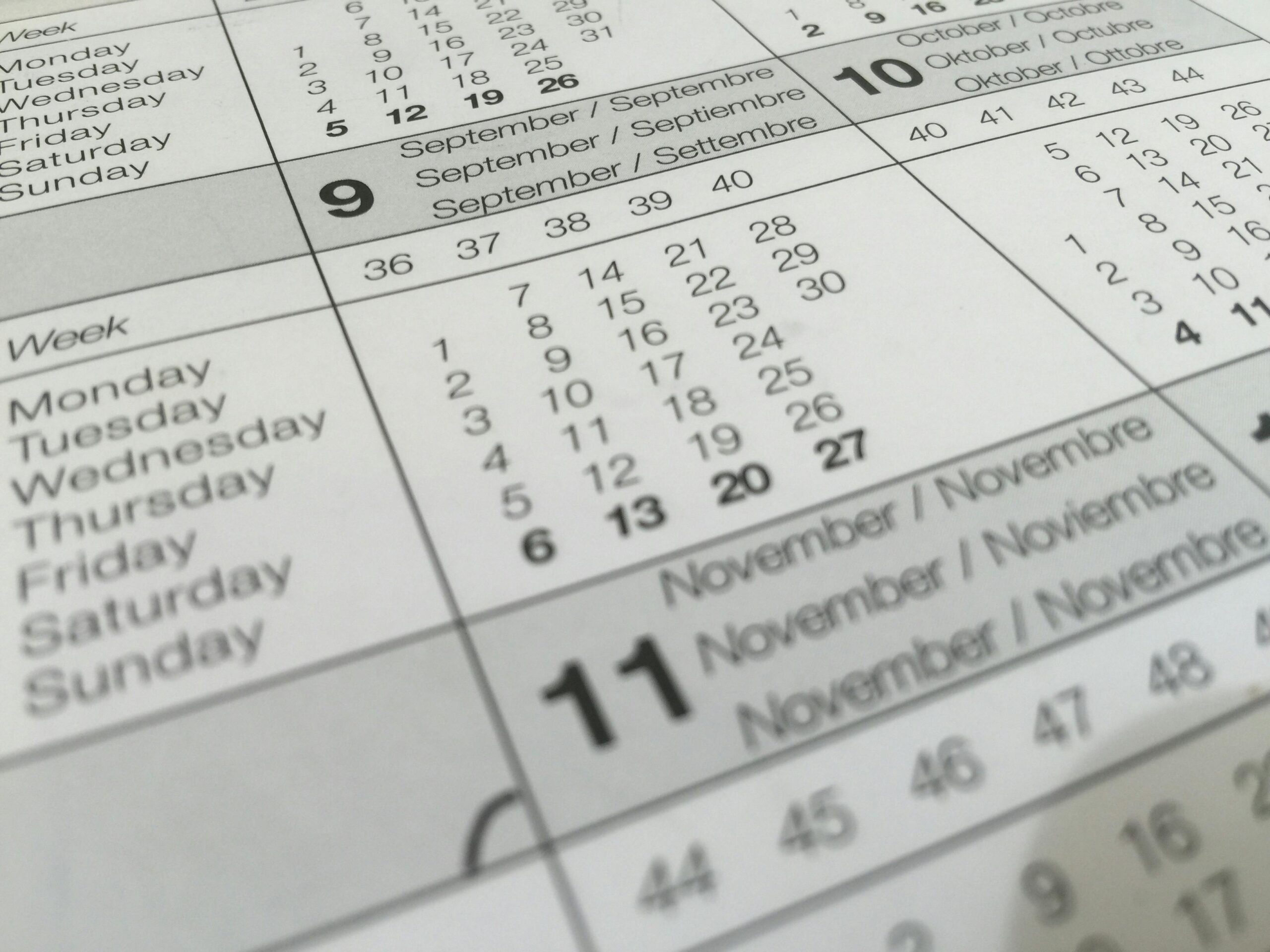Quand on voyage au Pérou, on croise très rapidement ces animaux tout à fait particuliers pour les européens. Ils sont là dans les rues de Cusco, dans les marchés, ou encore dans les montagnes de la Vallée Sacrée. On entend souvent les touristes dire « regarde un lama ! » alors que parfois ce n’est pas le cas, c’est un alpaga. Et si on sort un peu des sentiers battus, on peut même s’apercevoir qu’il existe également d’autres animaux qui ressemblent aux lamas et aux alpagas. Ce sont les guanacos ou bien les vigognes, des espèces plus sauvages mais tout aussi emblématiques des Andes. Pourtant, pour quelqu’un qui n’est pas habitué, ils se ressemblent beaucoup. L’objectif de cet article, c’est d’expliquer simplement quelles sont les vraies différences entre ces quatre animaux, qui font tous partie de la grande famille des camélidés sud-américains.
Un ancêtre commun :
L’alpaga, le lama, le guanaco et la vigogne sont des cousins proches. Ils appartiennent tous à la même famille, celle des camélidés, qui regroupe aussi les dromadaires et les chameaux. Mais contrairement à ces derniers, ils vivent dans les régions andines, souvent à plus de 3 000 mètres d’altitude. Parmi les quatre, deux sont domestiqués depuis longtemps : le lama et l’alpaga. Les deux autres, le guanaco et la vigogne, vivent encore à l’état sauvage, même si certaines populations sont protégées ou gérées dans des réserves. Tous ont un rôle important dans les traditions andines, que ce soit pour leur laine, leur force de travail ou leur simple présence dans les paysages.
Le plus connu, le lama :
Le lama est sans doute le plus connu, et aussi le plus grand. Il peut peser jusqu’à 150 kilos, ce qui en fait un excellent animal pour porter des charges. Les communautés andines l’utilisent depuis des siècles pour transporter toutes sortes de choses sur les chemins de montagne. Le lama a une silhouette élancée, un long cou, un museau assez allongé et surtout de grandes oreilles et une longue laine. Il a une démarche tranquille mais déterminée. C’est un animal robuste, qui peut être un peu têtu, et qui a la réputation de cracher quand il est énervé. Ce n’est pas une légende : le lama crache surtout sur ses congénères quand il veut affirmer sa dominance, mais il peut aussi viser un humain s’il se sent agressé. Malgré tout, il est très utile dans les régions andines, non seulement pour le transport, mais aussi pour sa viande, sa peau et parfois sa laine, même si celle-ci est de qualité moyenne par rapport à d’autres camélidés.
L’alpaga et sa laine :
L’alpaga, lui, est souvent confondu avec le lama, mais il est bien différent. Déjà, il est plus petit et plus léger, en général entre 55 et 65 kilos. Il a une tête plus courte et plus ronde, ce qui lui donne un air mignon et très apprécié des touristes. Ses oreilles sont droites et plus petites que celles du lama. Ce qui le rend vraiment unique, c’est sa laine : très épaisse, incroyablement douce, chaude et légère. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle on l’élève. L’alpaga est plus calme que le lama, il crache moins, et il est plus sociable, surtout s’il a grandi en contact avec des humains. Dans de nombreuses régions andines, sa laine représente une source de revenus importante, car elle est recherchée dans le monde entier pour la confection de vêtements de qualité. Ponchos, bonnets, écharpes et pulls en laine d’alpaga sont d’ailleurs très populaires dans les marchés locaux.
Le guanaco, une espèce sauvage :
Plus au sud, dans certaines parties reculées du Pérou, on trouve une autre espèce de camélidé : le guanaco. Il vit à l’état sauvage dans des zones parfois arides ou semi-désertiques, mais aussi dans les hauts plateaux andins. C’est un animal fin et élégant, au pelage court de couleur beige à brun clair, avec le ventre blanc. Il est plus fin que le lama, mais plus grand que l’alpaga. Sa tête est fine, ses oreilles sont longues et droites. Le guanaco est très rapide. Il fuit dès qu’il sent une présence humaine. Il peut courir à plus de 50 km/h, ce qui lui permet d’échapper à ses prédateurs dans des environnements parfois très ouverts. Même s’il n’est pas domestiqué, sa laine est de bonne qualité. Elle est récoltée dans certaines réserves de manière encadrée.
La vigogne, la perle des Andes :
Enfin, il y a la vigogne, sans doute la plus discrète mais aussi la plus précieuse. C’est la plus petite des quatre espèces. Elle vit en haute altitude, souvent au-dessus de 4 000 mètres, dans des régions très isolées. Son pelage est court, d’un beige doré éclatant, avec le ventre blanc. La vigogne a longtemps été menacée de disparition à cause de sa laine, la plus fine et la plus chère du monde. Cette laine est incroyablement douce, légère et chaude. Elle est si précieuse que les vêtements faits à partir de laine de vigogne peuvent coûter plusieurs milliers d’euros. Aujourd’hui, la chasse de vigogne est interdite, et elles ne peuvent être tondues que tous les trois à quatre ans, dans le cadre de cérémonies traditionnelles appelées « chaccu ». Pendant ces événements, les animaux sont capturés dans des enclos temporaires, tondus à la main, puis relâchés.
Connaître la différence entre ces quatre animaux, c’est aussi une manière de mieux comprendre la culture andine. Depuis l’époque des Incas, les camélidés font partie du quotidien des peuples des Andes avant la vache ou le cheval. Ils fournissent laine, nourriture, moyen de transport, et ont aussi une grande valeur symbolique. Par exemple, la vigogne est aujourd’hui l’animal national du Pérou. Elle est protégée par la loi et figure même sur le blason du pays. L’alpaga, lui, est devenu un symbole du tourisme péruvien, mais reste aussi essentiel pour l’économie de nombreuses familles des montagnes. Le lama continue d’être utilisé dans les campagnes reculées pour transporter les récoltes ou les marchandises.
En somme, bien que lamas, alpagas, vigognes et guanacos partagent un ancêtre commun et peuplent les hauts plateaux andins, chacun possède ses propres caractéristiques physiques, comportements et usages. Comprendre leurs différences, c’est mieux comprendre la richesse de la culture andine et la place essentielle qu’occupent ces camélidés dans la vie locale.